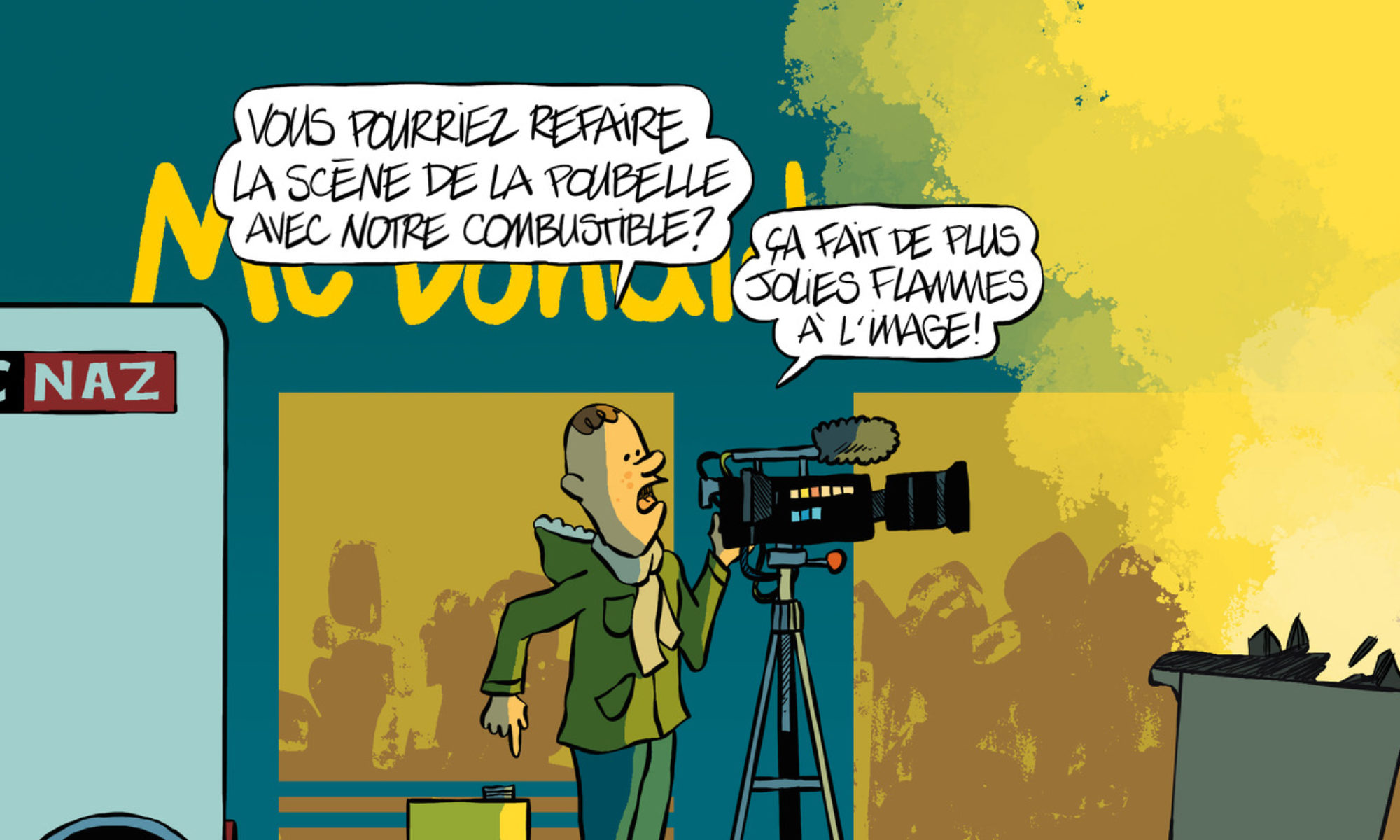Olivier Hamant, chercheur et biologiste à l’Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement (Inrae) au sein de l’ENS à Lyon, appelle la Métropole et la Ville de Lyon à renforcer ses projets d’autonomie face aux fluctuations socio-écologiques à venir, notamment via une « régie agroécologique », le soutien aux projets de santé préventive par l’alimentation locale ou les ateliers citoyens de réparation. Dans son ouvrage
La Troisième Voie du vivant, il propose des pistes d’action pour éviter la catastrophe et esquisse des solutions pour un avenir viable. Un entretien mené par Julia Blachon.L’Arrière-Scène : Dans votre ouvrage, vous mentionnez l’importance d’agir au niveau local pour continuer à vivre dans un monde qui devient de plus en plus turbulent . Quelles actions faudrait-il mettre en place sur le long terme pour lutter contre le dérèglement climatique et l’effondrement de la biodiversité ?
Olivier Hamant : L’agriculture est selon moi la principale action qui permettrait de répondre aux enjeux environnementaux, qu’ils soient le climat, les pollutions ou la biodiversité. Localement, cela se traduirait par une agroécologie forte. Il s’agit de penser le champ comme un écosystème, et donc de remplacer l’irrigation, les engrais et pesticides par des symbioses entre espèces. L’agroforesterie par exemple peut créer un microclimat à plus forte hydrométrie et créer de nouvelles interactions bénéfiques entre espèces. A Lyon, par exemple, une agriculture dite « urbaine et locale », pourrait améliorer les conditions sociales, économiques et environnementales de l’ensemble de la population. Il s’agirait finalement de penser la santé plus largement. Cet investissement s’accompagnerait bien sûr d’un changement des habitudes de consommation des habitants en incitant au circuit court.
Même si je suis conscient que ce n’est pas l’agriculture urbaine qui va nourrir l’ensemble des Lyonnais (rires), cette pratique est très positive d’un point de vue éducatif. On reconnecte ainsi les citoyens à leur alimentation, on fait évoluer les façons de penser, etc.
Le basculement vers « agroécologie », ne se fait pas en un claquement de doigts. Or, comme vous le précisez dans votre ouvrage, le temps est compté. Comment la Ville de Lyon et la Métropole peuvent-elles faire évoluer les mentalités et les habitudes de consommation de leurs habitants sur le court terme ?
L