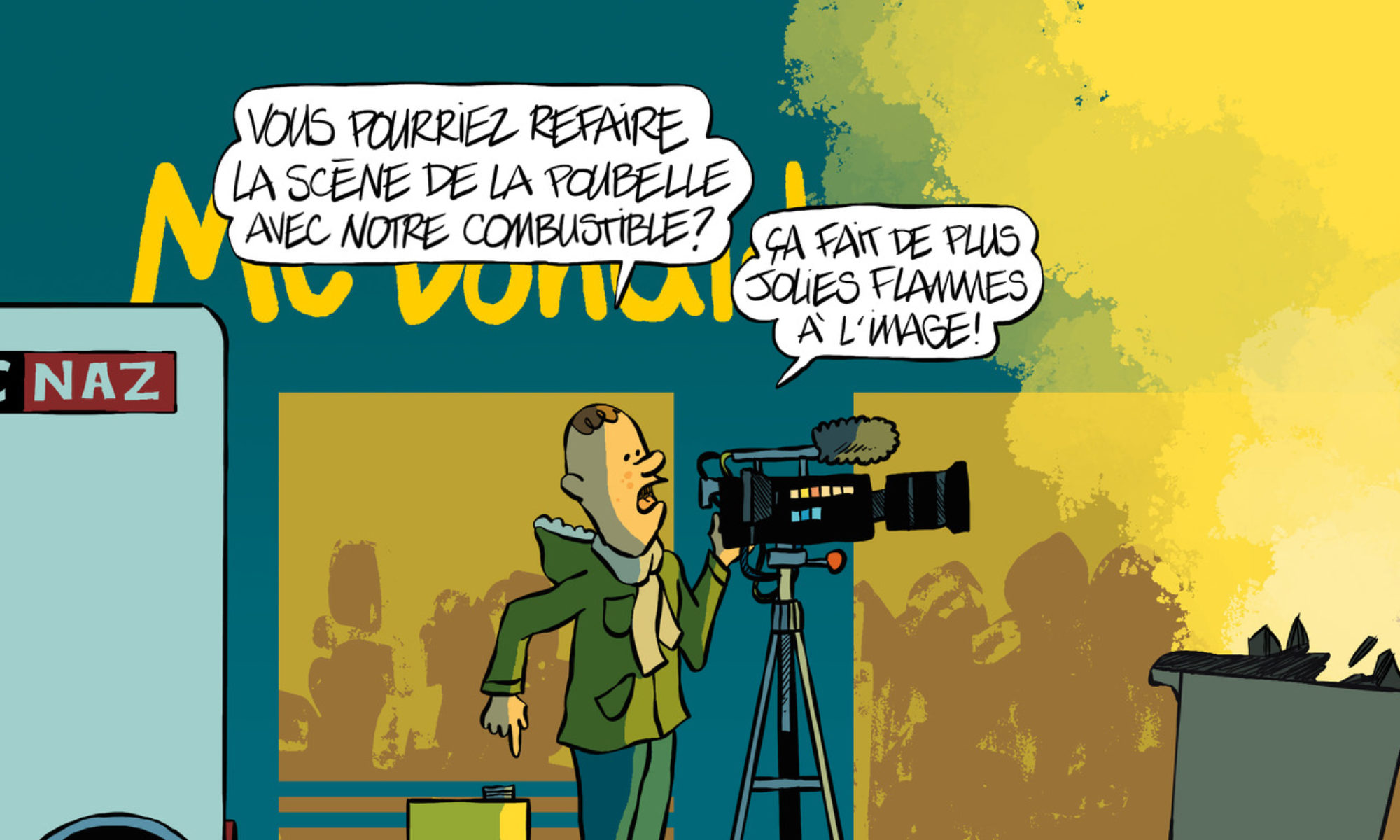Fascinée par le regard mystérieux du physicien depuis l’adolescence, Virginie Ollagnier consacre son quatrième roman,
Ils ont tué Oppenheimer, à un portrait aussi historique qu’intimiste du père de la bombe atomique. Dans un contexte où la responsabilité de Robert Oppenheimer résonne froidement avec les bombardements russes en Ukraine, l’autrice lyonnaise fait le récit de la chute tragique d’un scientifique aux idéaux pourtant humanistes. Dans un monde de guerre froide et de maccarthysme, sa volonté de retirer la bombe atomique des mains des militaires et de l’exécutif l’a conduit à un procès historique, divisant encore profondément les États-Unis. À travers ce long entretien réalisé par Anaëlle Hédouin et illustré par Sandrine Deloffre, L’Arrière-Cour dévoile les ficelles d’un roman funambulant entre fiction et histoire.L’Arrière-Cour : Quelle a été votre première rencontre avec Oppenheimer ?
Virginie Ollagnier : La première rencontre, je dois avoir 13 ou 14 ans, je suis en classe de physique-chimie. Il y a une frise autour de la salle avec des portraits de grands physiciens ; ils sont tous très sérieux, sauf un, Robert Oppenheimer, qui est particulièrement triste. Je m’arrête sur ce regard-là, qui va me poursuivre. Je découvre ensuite qui il est et je suis assez surprise de voir que le père de la bombe atomique peut avoir ce regard-là, parce que j’ai 13 ans et que je n’ai pas conscience des enjeux psychologiques d’une telle décision.
Vous dites que l’histoire d’Oppenheimer incarne « la mort de la gauche américaine ». Pouvez-vous nous expliquer votre réflexion ?
Disons qu’Oppenheimer l’incarne de la manière la plus visible. En suivant la campagne électorale américaine en 2016, ma fille m’a fait cette réflexion qui a été le déclencheur de ce roman. Elle m’a dit : « Mais maman, y a plus de gauche aux États-Unis. » Elle avait réalisé qu’en fin de compte, elle ne voyait pas dans les programmes un parti communiste comme on pouvait en trouver un en France, ou bien un parti comme La France insoumise. Alors je lui ai esquissé une généalogie de la mort de la gauche aux États-Unis, à travers les premières lois américaines des années 1919-1920 qui interdisaient l’opposition à la guerre, jusqu’au Patriot Act de George W. Bush en