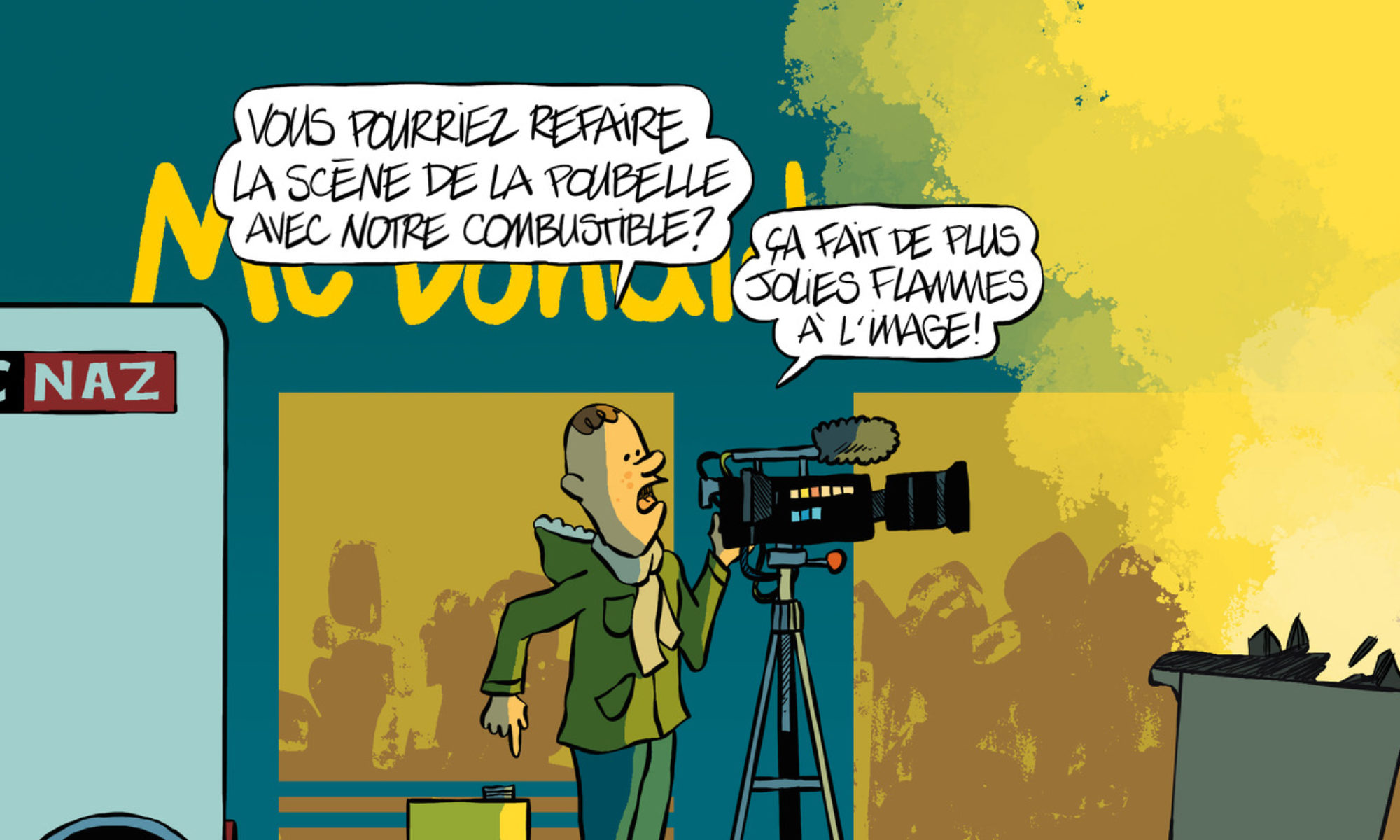Anne-Sophie Novel, autrice, journaliste et documentariste spécialiste de l’environnement, donnait une conférence au salon Primevère, à Eurexpo, le 26 février dernier. Elle y présentait son dernier livre,
L’Enquête sauvage – Pourquoi et comment renouer avec le vivant (éditions La Salamandre / Colibris), à la fois enquête journalistique et quête personnelle. L’Arrière-Cour en a profité pour rencontrer cette économiste de formation, qui montre comment l’observation et l’émerveillement permettent une curiosité autre que purement scientifique, qui retisse un lien profond avec la nature. Elle insiste sur le fait que « le moteur de l’action politique, sur ces sujets, comme sur le climat ou d’autres thèmes liés aux injustices sociales, passe par ces émotions et ressentis qui nourrissent ensuite l’action juste, et la posture profondément politique que nous devons tenir sur ces sujets ». Et déplore que ces thématiques soient complètement ignorées par la campagne présidentielle. Un entretien mené par Ariane Denoyel. Le portrait est signé de la photographe Julie Rey.L’Arrière-Cour : Vous reconnaissez vous-même qu’avec ce livre, commandé par Les Colibris et La Salamandre, vous auriez facilement pu tomber dans le piège de la journaliste bien intentionnée, un peu bobo, qui part à la découverte de la nature. Vous évitez cet écueil en mêlant l’intime, l’universel et le savant, en partant à la rencontre de personnes qui, sur le terrain, œuvrent à la reconnexion à la nature, en vous appuyant sur des chercheurs, philosophes, scientifiques… Quel en est le résultat pour vous ?
Anne-Sophie Novel : Au fil de cette enquête, j’ai ressenti une bascule, un profond changement intérieur. Une reconnexion avec le vivant, partout où il est présent. Et cela peut commencer dans un parc ou au bout de son jardin. Mon premier affût, je l’ai organisé à 300 mètres de chez moi, dans la région bordelaise, au bord d’un étang, en lisière de forêt. J’y suis allée avec ma fille de 10 ans. C’était le soir et, dans le silence, le lieu a pris une autre dimension. Nous sommes entrées dans un espace flou et méconnu et avons réalisé combien nos yeux, nos oreilles ne savent plus déceler ni discerner. Par exemple, moi qui étais très attachée à la proximité de l’eau, de la mer, j’ai ressenti combien le vent dans la canopée pouvait donner un sentiment océanique.
En affût, on questionne ses propres habitudes, sa façon d’être ; on travaille son style d’attention. Ainsi, j’ai réalisé que je parlais