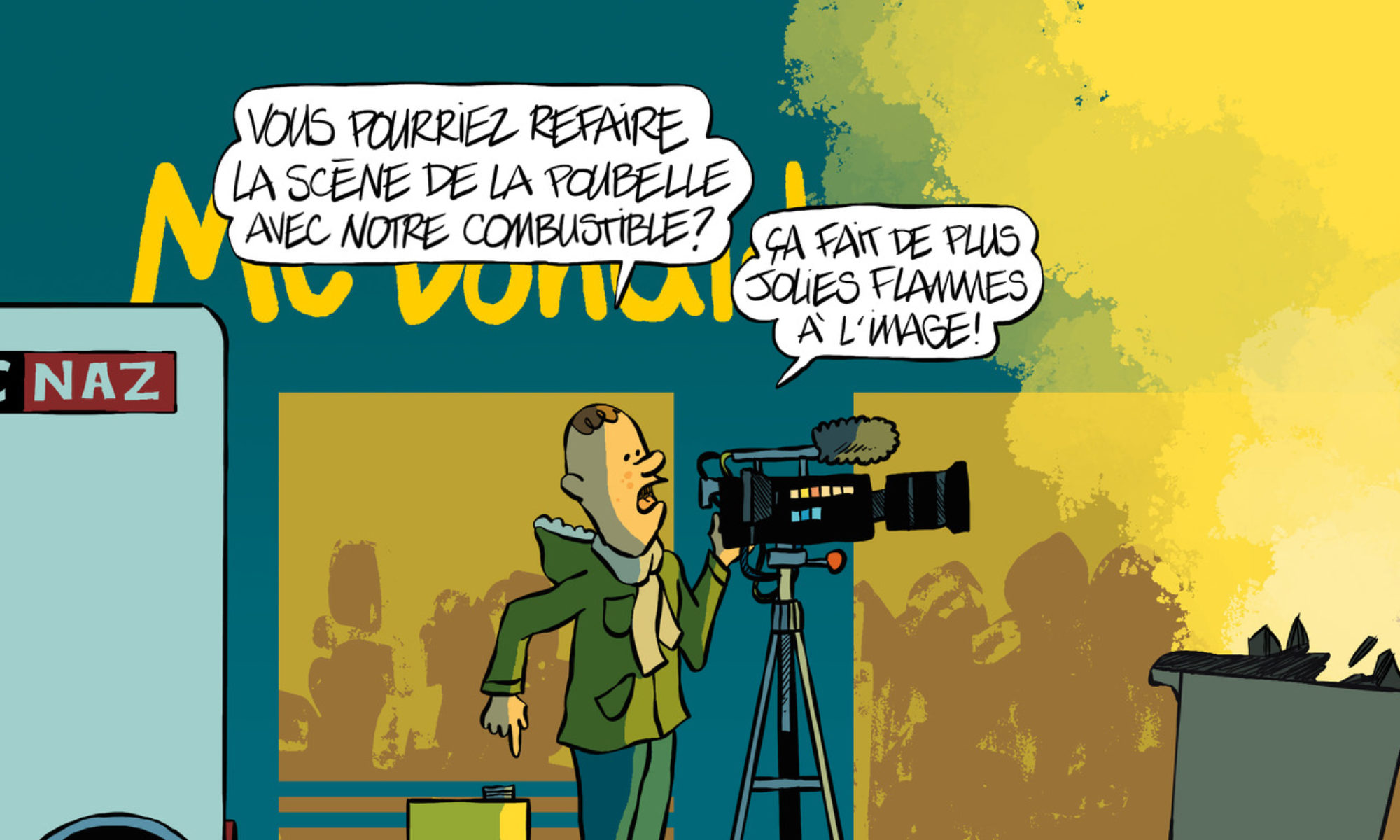Jalouse de son indépendance, l’association anti-corruption Anticor redoute de perdre dans les semaines qui viennent l’agrément accordé par le gouvernement, qui lui permet de se porter partie civile et, dans des affaires sensibles, de passer outre un classement sans suite du parquet. Nous avons rencontré Éric Alt, magistrat et vice-président de l’association, ainsi que Pauline Matveeff, sa référente locale. Celle-ci salue les progrès accomplis par les nouveaux exécutifs à la mairie et à la Métropole de Lyon… tout en pointant les contradictions et le chemin qui reste à parcourir. Une interview illustrée par la talentueuse Sandrine Deloffre.
L’Arrière-Cour : Anticor est partie civile dans trois affaires qui concernent le gouvernement. Or, son avenir à court terme dépend d’une décision de ce même gouvernement : celui-ci doit en effet renouveler l’agrément de trois ans grâce auquel vous pouvez vous porter partie civile dans les affaires de corruption. N’y a-t-il pas un problème dans le fonctionnement de cette lutte anti-corruption ?
Eric Alt : Ce problème était présent dès le départ. Les législateurs en 2013 ont donné la possibilité aux associations de lutte anti-corruption de demander un agrément. Le paradoxe, c’est que nous devons cet agrément au pouvoir que, forcément, nous agaçons. Nous ne pouvons qu’agacer le pouvoir ou les grands intérêts, puisque nous intervenons justement dans les affaires où le parquet se montre trop prudent parce qu’elles concernent le pouvoir… Dans les autres, la procédure suit généralement son cours et nous n’avons pas à intervenir.
Est-ce un agrément vital pour l’association ?
Vital non, mais important. Sans lui, nous pourrons toujours signaler des dossiers et informations au parquet, mais nous ne pourrons plus surmonter l’obstacle d’un classement sans suite et donc imposer la tenue d’un procès. Sans compter que, pour les dossiers où nous sommes déjà partie civile, un problème juridique se pose pour savoir si nous pourrons le rester et si l’instruction se poursuivra.
« Prenez l’affaire Richard Ferrand : si Anticor n’est plus là, le parquet reprendra-t-il l’affaire à son compte ? »
Quelles procédures pourraient être concernées ?
L’affaire Richard Ferrand, qui concerne ses fonctions en tant que dirigeant des Mutuelles de Bretagne. Si Anticor n’est plus là, le parquet reprendra-t-il l’affaire à son compte ? Je pense aussi à la procédure qui touche le se